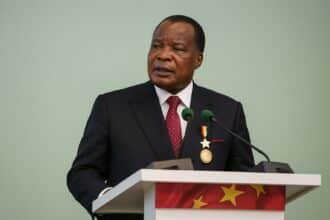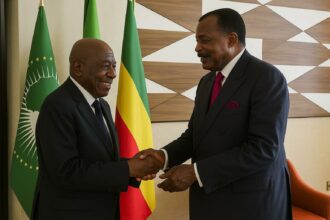Moscou et Bamako officialisent une feuille de route atomique
Sous les ors du Kremlin, le 23 mars 2024, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et son homologue russe Vladimir Poutine ont paraphé une feuille de route « d’usage pacifique de l’énergie nucléaire » couvrant la décennie 2024-2034, scellant ainsi la déclinaison opérationnelle du mémorandum signé l’an passé. Le document, dont les grandes lignes ont été rendues publiques par Rosatom le 26 mars (Rosatom, communiqué, 26 mars 2024), prévoit la construction d’un réacteur modulaire de 55 MW près de Bamako, l’envoi d’une centaine d’ingénieurs maliens en formation à Novossibirsk dès septembre 2024 et la création d’un institut conjoint de sûreté radiologique.
- Moscou et Bamako officialisent une feuille de route atomique
- Pénurie chronique et quête de légitimité énergétique
- Des garde-fous internationaux encore flous
- Réactions régionales et dynamiques concurrentes
- Dimension sécuritaire : entre parapluie russe et inquiétudes occidentales
- Entre promesses économiques et inconnues financières
- Perspectives : un test grandeur nature pour la gouvernance énergétique sahélienne
Pénurie chronique et quête de légitimité énergétique
Avec un taux d’électrification rural inférieur à 20 %, le Mali voit dans l’atome une réponse aux coupures récurrentes qui fragilisent l’activité minière et industrielle. Lors de son intervention au Forum russo-africain de l’énergie, le ministre malien des Mines, Bintou Camara, a rappelé que « les déficits de 300 MW enregistrés à la pointe sèche de l’harmattan coûtent chaque mois 1,5 % du PIB » (Forum russo-africain de l’énergie, Moscou, 24 mars 2024). L’option nucléaire, étape suprême du recentrage stratégique vers Moscou entamé depuis 2021, nourrit également une narration souverainiste : en diversifiant ses approvisionnements, la junte entend se défaire de la dépendance vis-à-vis des bailleurs traditionnels qui conditionnaient leur aide à des progrès démocratiques.
Des garde-fous internationaux encore flous
Saisie par Bamako, l’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé avoir reçu, le 15 avril 2024, la notification formelle d’un « projet de première installation nucléaire de catégorie 1 » ; l’organisation rappelle toutefois que le Mali devra présenter d’ici décembre un cadre législatif intégral sur la sûreté, la non-prolifération et les garanties (IAEA, point presse, 17 avril 2024). À Vienne, plusieurs délégations occidentales doutent de la capacité institutionnelle malienne à assurer la protection physique du combustible ou à mettre en place une autorité de régulation indépendante, évoquant un « risque de précédent » dans une région confrontée à la circulation illicite d’armes.
Réactions régionales et dynamiques concurrentes
Le Niger, traditionnel fournisseur d’uranium d’EDF et pivot logistique des forces occidentales expulsées du Mali, observe l’accord avec circonspection. Dans une note interne révélée par Sahel-Intelligence le 4 avril 2024, Niamey redoute « une polarisation accrue qui pourrait mercenariser l’expertise nucléaire dans l’espace CEDEAO ». À Abuja, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a inscrit la question à son prochain sommet extraordinaire, rappelant que son Protocole de 2008 sur l’énergie impose la notification préalable de tout projet transfrontalier présentant un risque radiologique.
Dimension sécuritaire : entre parapluie russe et inquiétudes occidentales
Le même jour que la signature du protocole, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou annonçait l’envoi de 250 instructeurs supplémentaires pour sécuriser les futurs sites sensibles (Reuters, 25 mars 2024). Washington a réagi en rappelant que son dispositif de sanctions CAATSA pourrait être appliqué à toute entité soutenant matériellement le programme. Paris, par la voix de Catherine Colonna, a dénoncé « un transfert technologique opaque susceptible d’alimenter de nouvelles dépendances » (conférence de presse, 28 mars 2024).
Entre promesses économiques et inconnues financières
Rosatom estime le coût du réacteur à 750 millions de dollars, financés pour moitié par un prêt concessionnel russe libellé en roubles, le solde étant adossé aux recettes aurifères maliennes dans le cadre d’un mécanisme de remboursement indexé sur le cours mondial de l’or. La Banque africaine de développement n’a, à ce stade, pas été sollicitée. Selon un rapport du cabinet sud-africain Infranomics publié le 9 avril 2024, la consommation intérieure actuelle ne suffirait toutefois pas à rentabiliser l’investissement avant 2045, sauf à créer un corridor d’exportation vers la Côte d’Ivoire.
Perspectives : un test grandeur nature pour la gouvernance énergétique sahélienne
Le pari nucléaire malien cristallise les tensions entre impératif de développement et calculs géopolitiques. À court terme, l’expertise russe confère à Bamako une marge de manœuvre inédite face aux bailleurs occidentaux. À moyen terme, la viabilité du projet dépendra de sa capacité à convaincre l’IAEA et à sécuriser durablement les sites dans une zone où les cellules affiliées à l’État islamique demeurent actives. Enfin, la naissance d’un hub nucléaire sahélien pourrait rebattre les cartes énergétiques régionales, relançant la compétition pour l’attraction d’investissements extra-continentaux. L’accord signé à Moscou fonctionne donc comme un révélateur : il annonce une ère où la diplomatie énergétique s’articule étroitement avec les jeux d’influence sécuritaires.