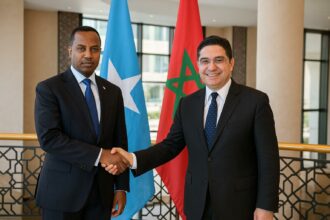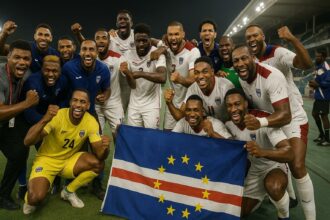Brazzaville consolide son influence sécuritaire régionale
Le 27 juin, au cœur de la capitale congolaise, la cérémonie de clôture de la 16ᵉ année académique de l’École de génie travaux a offert un instantané saisissant du rayonnement militaire de la République du Congo. En présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, la remise des brevets a rassemblé officiers, attachés de défense et représentants d’organisations régionales, soulignant la dimension désormais diplomatique de l’institution. Sous l’impulsion constante du président Denis Sassou Nguesso, Brazzaville revendique ainsi une capacité de projection d’influence fondée non pas sur la posture, mais sur le partage du savoir-faire technique.
Une pédagogie fondée sur la technicité du génie travaux
Au fil de trois modules structurants – le cours de perfectionnement des officiers subalternes, le cours d’application et le certificat technique deuxième degré option Énergie –, l’École forge des spécialistes capables de passer du piquet topographique à la conduite d’engins blindés d’ingénierie. Les laboratoires de géotechnique, les ateliers de maçonnerie et la plateforme pédagogique dédiée aux fluides industriels traduisent la volonté de coller aux besoins opérationnels : exploiter un puits artésien dans la Likouala, sécuriser un pont flottant dans le Liptako ou rétablir le courant après un cyclone sur la côte mozambicaine.
Capillarité africaine et diplomatie des stages
Les promotions comptent désormais plus d’internationaux que de nationaux, un choix assumé qui fait de l’Académie Marien-Ngouabi un forum discret où se tissent, à l’ombre des salles de cours, des réseaux d’amitié interarmées. Cette année, trente-huit stagiaires venus de dix-huit pays – du Sénégal à Madagascar – ont échangé procédures, cartographies et retours d’expérience sur la stabilisation post-conflit. « La coopération du Congo n’est pas un slogan ; elle s’apprend en bottes et en bleu de travail », confie un capitaine nigérien fraîchement diplômé, illustrant la vocation très pragmatique de la diplomatie de défense congolaise.
Un instrument de modernisation interne des FAC
La dimension extérieure de l’école ne doit pas occulter son rôle de catalyseur interne. Sur les 3 275 personnels formés en seize ans, plus de 1 500 appartiennent aux Forces armées congolaises. Les chantiers pilotes réalisés par les stagiaires – remise à niveau de l’aérodrome d’Oyo, réhabilitation de casernes dans la Cuvette ou construction de postes fluviaux sur l’Alima – témoignent d’un transfert direct vers la manœuvre nationale. Les officiers du génie ainsi certifiés deviennent les chevilles ouvrières de la nouvelle doctrine logistique des FAC, axée sur la mobilité interthéâtre et l’autonomie en infrastructures légères.
Perspective énergie et résilience logistique
Le certificat technique option Énergie, introduit il y a cinq ans, répond à un impératif stratégique : garantir la continuité électrique des postes de commandement avancés, souvent hors réseau. L’accent mis sur les générateurs hybrides et le solaire de terrain anticipe les contraintes budgétaires et écologiques qui s’imposent aux armées du continent. « L’autonomie énergétique conditionne la réussite d’une opération de maintien de la paix », rappelle le colonel-major Armand Pascal Mboumba, directeur général de l’école, pour qui la formation d’électriciens militaires est aussi cruciale que celle des sapeurs.
La valeur stratégique d’une école pérenne
Forte d’un taux de réussite supérieur à 95 % et d’une visibilité accrue auprès de l’Union africaine, l’École de génie travaux s’affirme comme une plateforme durable de sécurité collective. Les États partenaires y voient un moyen de mutualiser la formation tout en préservant leur souveraineté, loin des rivalités de prestataires extra-continentaux. Brazzaville, pour sa part, capitalise sur cette attractivité pour renforcer son réseau d’alliances, gage d’un environnement sous-régional apaisé et propice au développement. En attachant son nom à cette réussite, la République du Congo démontre que la puissance douce peut, parfois, se mesurer au nombre de ponts bâtis plutôt qu’au tonnage des blindés.