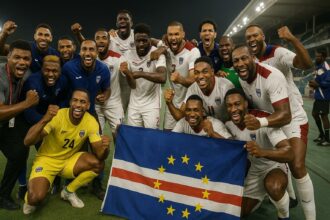Visite académique ou diplomatie en treillis ?
Le 24 juin, le tarmac de Maya-Maya a vu descendre vingt-deux officiers zimbabwéens emmenés par le général de brigade Francis Chakauya, numéro deux de l’Université de la défense nationale (UDN). Officiellement, il s’agissait d’un simple « voyage d’étude » du cours 13/2024 ; officieusement, le calendrier, les porte-folios et les interlocuteurs rencontrés trahissaient un exercice de diplomatie militaire à part entière. Le Congo, friand de partenariats Sud-Sud discrets, a déroulé un protocole proche d’une visite d’État : accueil par le haut commandement, accès total aux amphithéâtres et signature du livre d’or de l’Académie militaire Marien-Ngouabi (ACMIL).
Pour Brazzaville comme pour Harare, la symbolique est forte : deux armées issues d’histoires révolutionnaires distinctes mais baignées dans une culture continentaliste se retrouvent dans un cadre académique, loin des regards des bailleurs occidentaux. « Nos pays ont besoin de s’appuyer d’abord sur leurs propres savoir-faire », a insisté le général Chakauya, en saluant « la capacité des Africains à se former sur des équipements de pointe sans dépendre d’autrui ». Un message politique adressé aux chancelleries, mais aussi aux marchés d’armement.
ACMIL et EGT : vitrines technologiques de Brazzaville
Sous la conduite du colonel Lié Cyr Guy Logangué, commandant de l’ACMIL, et du colonel-major Armand Pascal Mboumba, directeur de l’École de génie travaux (EGT), la délégation a arpenté salles de cours connectées, ateliers de maquettes et, surtout, le fameux simulateur de tir indirect récemment modernisé avec l’appui de techniciens sud-africains. Cet outil, capable de reproduire les trajectoires balistiques des obusiers de 122 mm ou des mortiers 120 mm, constitue la pièce maîtresse de la proposition congo-gabonaise : former à moindre coût, sans user le tube ni brûler le kérosène.
Les ingénieurs congolais ont également présenté une station de modélisation 3D des théâtres centrafricains, fruit d’un partenariat avec l’université Marien-Ngouabi. Pour les stagiaires zimbabwéens, rompus au bushveld du Matabeleland, la découverte d’une reconstitution interactive de la savane oubanguienne a offert un aperçu concret des contraintes d’une future projection sous mandat onusien. Les échanges techniques ont vite glissé vers des discussions sur la souveraineté numérique, la maintenance locale et le coût d’acquisition des licences logicielles, démontrant que la coopération sud-sud ne se limite plus aux défilés protocolaires.
Formation conjointe et enjeux capacitaires africains
Le Congo exporte-t-il désormais un savoir-faire militaire ? L’idée, impensable il y a encore dix ans, prend corps à la faveur d’un double mouvement : retrait partiel des instructeurs occidentaux et montée en gamme de certaines académies africaines. L’UDN, confrontée depuis 2017 à des contraintes budgétaires et à des sanctions internationales, cherche des terrains d’entraînement alternatifs moins onéreux que les bases privées sud-africaines. Brazzaville y voit l’occasion de monétiser ses dispositifs pédagogiques tout en consolidant un réseau d’alliés.
La présence de trois officiers généraux et de l’attaché de défense du Zimbabwe révèle la dimension politico-industrielle de la tournée. Harare explore les pistes de codéveloppement d’un centre de simulation terrestre inspiré du modèle congolais, tandis que l’état-major congolais sonde les opportunités de cofinancement d’un futur pôle d’instruction au déminage humanitaire dans la zone de Kintélé. Au-delà des discours, les agendas laissent entrevoir une convergence : mutualiser les coûteux effets majeurs (simulateurs, bancs d’essais, drones d’observation) pour créer une masse critique continentale face à la concurrence asiatique et moyen-orientale.
Maintien de la paix, un argument de soft power congolais
La visite a été ponctuée d’une conférence en deux volets sur l’expérience congolaise en opérations de maintien de la paix. Le colonel-major Bellarmin Ndongui a retracé le déploiement des bataillons congolais au sein de la MINUSCA, insistant sur la logistique fluviale comme avantage comparatif. Son collègue, le colonel Serge Loungui, a détaillé les retours d’expérience en matière de protection des civils et de coordination inter-agences. Pour le Zimbabwe, qui aligne déjà des observateurs au Soudan du Sud, la perspective d’un entraînement préalable en zone équatoriale offre la promesse d’une meilleure acclimatation tactique.
Le lendemain, le secrétaire permanent du Comité interministériel de l’Action de l’État en mer, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a élargi le débat à la gouvernance maritime du golfe de Guinée. L’orateur a souligné la complémentarité entre formation terrestre et maîtrise du domaine maritime, rappelant que 90 % du commerce extérieur zimbabwéen transite par les ports mozambicains, eux-mêmes vulnérables aux mêmes réseaux criminels opérant au large de Pointe-Noire. En articulant maintien de la paix et sûreté maritime, Brazzaville soigne son image de pourvoyeur de stabilité régionale.
Perspectives régionales, du Zambèze au fleuve Congo
Au soir du 24 juin, la délégation a rejoint le port pétrolier de Pointe-Noire pour inspecter la zone militaire n°1. Si l’étape n’a pas livré de communiqué officiel, plusieurs sources évoquent l’hypothèse d’un détachement zimbabwéen dans un futur exercice amphibie trilatéral avec la République démocratique du Congo et l’Angola. Le général Guy Blanchard Okoï, chef d’état-major général congolais, a plaidé pour « une force africaine réellement interopérable, capable de passer de la brousse aux estuaires sans rupture de chaîne de commandement ».
En toile de fond, se dessine une cartographie nouvelle des influences : la Chine équipe Harare en blindés légers, la Russie propose des hélicoptères Mi-35, et Paris cherche à sauver sa coopération structurelle avec Brazzaville. Dans ce jeu feutré, la formation académique devient la monnaie d’échange la plus discrète et la plus durable. Si les simulateurs de l’ACMIL ont séduit les officiers zimbabwéens, il reste à transformer l’essai en programmes conjoints crédibles, inscrits dans la durée budgétaire et politique. À l’heure où l’African Standby Force peine à franchir le stade conceptuel, cette entente Congo-Zimbabwe, modeste par sa taille mais robuste par son pragmatisme, pourrait bien annoncer une renaissance de l’intégration sécuritaire continentale.