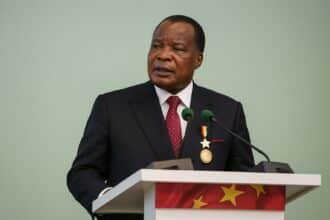Une visite académique, vitrine d’un soft power en treillis
En conviant vingt-deux auditeurs zimbabwéens du cours 13/2024 de l’Université de la défense nationale, Brazzaville a subtilement mué ses enceintes militaires en instruments diplomatiques. À l’Académie militaire Marien-Ngouabi, puis à l’École de génie travaux, la délégation conduite par le général de brigade Francis Chakauya a parcouru amphithéâtres, salles de simulation et ateliers de topographie, découvrant une architecture pédagogique inspirée des standards francophones mais adaptée aux réalités sub-sahariennes. L’accueil de haut rang, orchestré par le colonel Lié Cyr Guy Logangué et le colonel-major Armand Pascal Mboumba, souligne la volonté congolaise de se positionner comme pôle régional de formation, là où Dakar ou Koulikoro, jusque-là, détenaient la primeur.
- Une visite académique, vitrine d’un soft power en treillis
- La technologie de simulation, fer de lance d’une autonomie africaine
- Maintien de la paix : la doctrine congolaise en partage
- Sécurité maritime : l’enjeu stratégique des eaux continentales
- Entre Harare et Brazzaville, une diplomatie sécuritaire à géométrie variable
- Perspectives industrielles et capacitaires
- Un partenariat inscrit dans la cartographie sécuritaire régionale
- Vers une normalisation africaine de la formation d’état-major
La technologie de simulation, fer de lance d’une autonomie africaine
Au cœur de la tournée, le simulateur tactique de dernière génération a cristallisé l’intérêt des visiteurs. Pour le général Chakauya, la capacité à « s’entraîner sur les équipements qui peuvent nous aider à nous défendre » traduit une double ambition : émanciper les armées africaines de la dépendance aux stages onéreux en Europe, et favoriser un transfert de savoir-faire vers des ingénieries locales. Derrière l’effervescence, les industriels sud-africains et congolais voient se dessiner un marché de pièces détachées et de maintenance évalué, selon un consultant basé à Johannesbourg, à plusieurs millions de dollars sur cinq ans.
Maintien de la paix : la doctrine congolaise en partage
Deux exposés ont dévoilé aux auditeurs l’expérience congolaise au sein de la MONUSCO et de la MINUSCA. Le colonel-major Bellarmin Ndongui a détaillé la préparation pré-déploiement, insistant sur la coordination interarmées et la maîtrise des procédures onusiennes de règles d’engagement. Son homologue, le colonel Serge Loungui, a quant à lui mis en lumière l’épineuse question du retour d’expérience, sujet encore trop souvent négligé dans les capitales africaines. Pour Harare, engagée au Soudan depuis 2019, l’expertise congolaise constitue un guide pragmatique, en particulier sur la gestion du stress opérationnel des contingents francophones au contact d’intervenants anglophones.
Sécurité maritime : l’enjeu stratégique des eaux continentales
Le volet maritime, présenté par Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a apporté une profondeur géopolitique au séjour. Alors que le golfe de Guinée concentre plus de 90 % des incidents de piraterie du continent, l’harmonisation des dispositifs de contrôle fluvial et côtier est devenue un impératif. Le Zimbabwe, État sans façade maritime, s’intéresse néanmoins au concept d’« Action de l’État en mer » pour sécuriser ses corridors d’approvisionnement via Beira et Durban, un rappel que la souveraineté logistique dépasse la seule topographie.
Entre Harare et Brazzaville, une diplomatie sécuritaire à géométrie variable
La réception officielle par le chef d’état-major congolais, le général de brigade Guy Blanchard Okoï, a scellé une relation qui s’inscrit dans la densification des partenariats Sud-Sud. À l’heure où les grandes puissances recalibrent leurs implantations en Afrique, les capitales régionales cherchent des alliances moins exposées aux aléas des sanctions internationales. Un officier congolais glisse qu’« échanger des stagiaires coûte moins cher qu’acheter des chars, mais peut rapporter autant d’influence ». Harare, sous le coup de restrictions occidentales depuis deux décennies, voit dans cette coopération francophone une voie d’accès à une doctrine multilingue, enrichie de codes OTAN et de standardisation onusienne.
Perspectives industrielles et capacitaires
La présence de cadres de l’École de génie travaux n’est pas anodine : elle ouvre la voie à des contrats de co-production d’ouvrages défensifs, de ponts modulaires ou de casernements préfabriqués. Le Congo ambitionne d’exporter son savoir-faire en maintenance d’infrastructures lourdes, tandis que le Zimbabwe cherche à moderniser ses bases de Gweru et de Bulawayo. Dans cette équation, la Banque africaine de développement, sollicitée pour financer des programmes d’ingénierie duale, pourrait devenir l’arbitre budgétaire d’une coopération désormais adossée à des retombées économiques tangibles.
Un partenariat inscrit dans la cartographie sécuritaire régionale
La tournée s’est achevée dans la zone de défense n° 1 de Pointe-Noire, interface stratégique entre Atlantique et hinterland congolais. Cette étape a rappelé que la maîtrise des littoraux est aussi cruciale pour les États enclavés, tributaires des flux pétroliers et miniers. En ancrant la relation avec Harare dans un continuum terre-mer, Brazzaville tisse une toile d’interopérabilité susceptible de se déployer demain dans des opérations conjointes de lutte contre le terrorisme, de sécurisation d’oléoducs ou de protection de corridors ferroviaires.
Vers une normalisation africaine de la formation d’état-major
Au-delà des échanges cordiaux et des signatures de livres d’or, la séquence congolaise illustre un mouvement de fond : la constitution progressive d’un réseau continental de collèges interarmées capables de délivrer un diplôme calibré sur les standards de la Communauté de développement d’Afrique australe et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. L’objectif, à terme, est clair : réduire la dépendance vis-à-vis des War Colleges occidentaux et renforcer la résilience stratégique africaine. À la sortie de l’amphithéâtre, un auditeur zimbabwéen confie, le visage grave : « Nous ne venons plus chercher des modèles, nous venons forger le nôtre. »