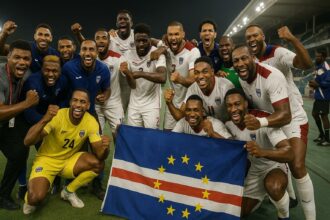Un record commercial au parfum stratégique
En annonçant 134,16 milliards de dollars d’échanges entre janvier et mai 2025, l’ambassadeur chinois au Ghana a salué un « signe tangible de confiance mutuelle ». Moins audible, mais tout aussi déterminant, se profile le volet sécuritaire de cette relation économique. Pékin consolide, pour la seizième année consécutive, sa primauté commerciale sur le continent africain, renforçant du même geste une profondeur stratégique essentielle à sa politique de projection en océans Indien et Atlantique. Pour de nombreux diplomates, chaque conteneur expédié n’est pas seulement un flux marchand : il constitue un filament d’influence, tissé dans le canevas plus large de la politique étrangère et de défense chinoise.
Dualité des marchandises exportées par Pékin
Les statistiques douanières annoncent une hausse de 20,2 % des exportations chinoises vers l’Afrique, à 83,51 milliards de dollars. Si le textile à bas coût reste visible, les observateurs militaires retiennent surtout la montée en gamme des machines-outils, des drones civils et des systèmes électroniques susceptibles d’un emploi dual. À Abuja, un haut fonctionnaire du ministère nigérian de la Défense confie que « certaines chaînes d’usinage importées pour l’industrie automobile peuvent, avec un simple changement de logiciel, produire des composants aérospatiaux ». Ce glissement technique, difficile à réguler, alimente les interrogations sur la capacité des services de contrôle africains à distinguer équipement civil et potentiel militaire, alors que Pékin entretient déjà des contrats d’armement plus classiques, notamment en matière de véhicules blindés légers.
Ports, fibres optiques et bases militaires : la logistique avant tout
Le déficit commercial africain – 32,86 milliards de dollars sur cinq mois – n’est que la partie visible d’un système où les infrastructures constituent la clé de voûte. Qu’il s’agisse du port en eau profonde de Lamu au Kenya ou du corridor ferroviaire Lobito en Angola, la signature financière chinoise accompagne généralement un volet logistique à haute valeur stratégique. Le complexe portuaire de Kribi, au Cameroun, doté d’une zone de radoub pouvant accueillir des frégates de 4 000 tonnes, illustre cette convergence entre commerce et projection navale. Depuis Djibouti, première base extérieure de l’Armée populaire de libération, Pékin teste sa capacité d’intervention à longue distance ; le maillage d’escales financées par ses banques d’ex-importation complète désormais ce dispositif.
Diplomatie des droits de douane et compétition avec Washington
La décision d’exonérer de droits 98 % des produits en provenance de vingt-et-un pays africains, étendue récemment aux trente-trois PMA du continent, illustre une diplomatie tarifaire offensive. Elle vise autant à apaiser les critiques sur l’asymétrie qu’à damer le pion aux États-Unis, revenus en force via l’Invest in Africa Act de 2024. « Les préférences chinoises créent une dépendance douce, car elles restent révocables politiquement », analyse une source européenne au Service diplomatique de l’UE. Pékin prépare désormais une suppression générale des droits pour l’ensemble de ses partenaires africains ; le calendrier exact demeure flou, mais l’intention coïncide avec l’activation du Commandement américain pour les transports sur le port ghanéen de Tema, signe que la rivalité sino-américaine gagne les côtes d’Afrique de l’Ouest.
Vers une asymétrie durable ?
Les exportations africaines demeurent concentrées sur le pétrole, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, leurs cours souffrant d’une volatilité accrue. Cette dépendance consolide l’excédent chinois et restreint la marge de manœuvre budgétaire des États pour investir dans le secteur de la défense ou la modernisation industrielle. Les initiatives de diversification – filières pharmaceutiques au Sénégal, assemblage de satellites au Maroc – évoluent encore à la périphérie des grands flux commerciaux. « Sans montée en gamme de la production africaine, le déficit se traduira mécaniquement par une dépendance sécuritaire à moyen terme », avertit le chercheur sud-africain Kwame Madondo, spécialiste des finances de défense. La question n’est donc pas uniquement économique : elle touche aux capacités opérationnelles futures, à la souveraineté technologique et, in fine, à l’autonomie stratégique d’un continent où s’esquisse déjà la prochaine course aux bases militaires.
Regards prudents des chancelleries africaines
Face à la dynamique actuelle, plusieurs capitales africaines s’efforcent de conjuguer attractivité chinoise et diversification des partenariats sécuritaires. L’accord de coopération défense signé entre le Kenya et le Royaume-Uni en avril 2025, ou encore l’entraînement conjoint des forces spéciales ivoiriennes avec la France dans le golfe de Guinée, témoignent de cette recherche d’équilibre. Si la Chine demeure un bailleur incontournable, les diplomates africains s’attachent à éviter le piège d’une dépendance unique qui pourrait contraindre leurs options en matière de politique de défense. La décennie qui s’ouvre risque de voir la statistique commerciale se muer en véritable indicateur d’influence stratégique, où ports, fibres optiques et satellites compteront autant que les volumes de coton ou de cuivre.