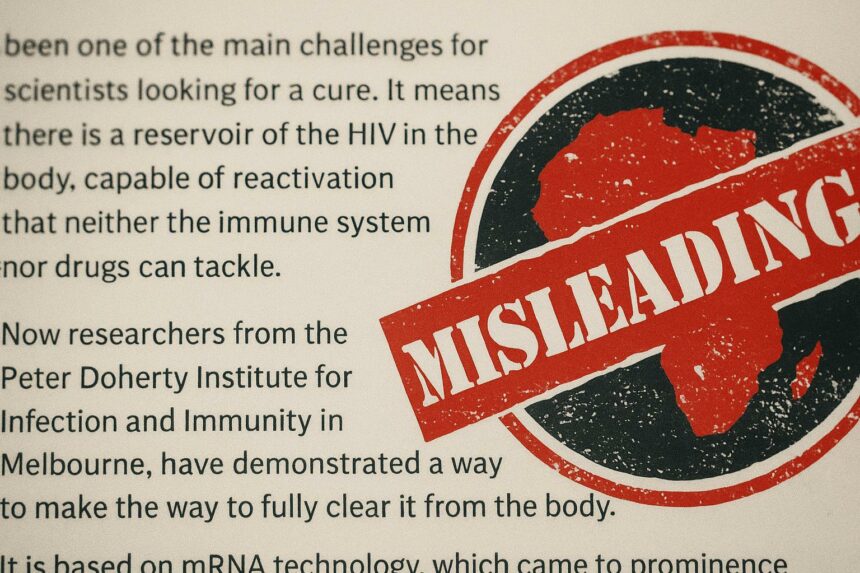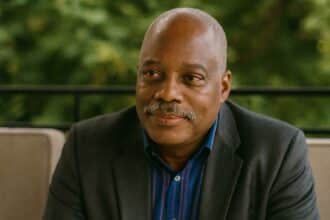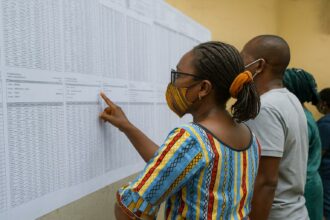Une percée scientifique vite récupérée par la désinformation en ligne
Le 5 juin 2025, la publication d’un article dans Nature Communications a offert un espoir mesuré : des chercheurs australiens ont réussi, in vitro, à « débusquer » le VIH dans certaines cellules immunitaires grâce à une séquence d’ARN messager. L’innovation, encore très éloignée de la mise sur le marché, n’a pourtant mis que quelques heures à être détournée sur les réseaux sociaux. Des messages revendiquant des millions de vues promettaient déjà un « vaccin » ou pire, un « remède » définitif. Cet emballement, loin d’être anecdotique, illustre la porosité entre la sphère scientifique et l’espace informationnel non régulé. Il démontre surtout que la désinformation médicale constitue désormais un front à part entière, où l’absence de doctrine claire place autorités de santé et agences de sécurité devant un défi commun.
- Une percée scientifique vite récupérée par la désinformation en ligne
- Les réseaux sociaux, nouveaux vecteurs d’instabilité sanitaire
- Entre santé publique et sûreté nationale, l’alerte des milieux de défense
- Bio-sécurité et renseignement : cartographie des menaces émergentes
- Vers une doctrine intégrée de lutte contre les infox médicales
Les réseaux sociaux, nouveaux vecteurs d’instabilité sanitaire
Dans un contexte post-pandémique, la viralité d’un contenu ne se mesure plus à l’aune de son exactitude mais de sa charge émotionnelle. Les fabricants d’infox l’ont compris : en associant un visuel généré par intelligence artificielle à un lexique triomphaliste, ils activent les algorithmes de recommandation, maximisent l’engagement et court-circuitent les garde-fous éditoriaux. Or, l’effondrement brutal de la confiance dans les traitements antirétroviraux, pourtant éprouvés, constitue une menace sanitaire immédiate. À Pretoria comme à Washington, les services de santé militaire observent déjà des retards dans l’adhésion thérapeutique parmi les jeunes recrues séropositives, sensibles à des contenus niant l’efficacité des traitements actuels. « Les plateformes deviennent un multiplicateur de risques comparable aux vecteurs biologiques », confie un officier santé de l’US Africa Command.
Entre santé publique et sûreté nationale, l’alerte des milieux de défense
Longtemps cantonnée aux experts de santé, la question du VIH réintègre désormais la grille de lecture stratégique. Les armées professionnelles, notamment dans les pays à forte prévalence, reposent sur la disponibilité opérationnelle de personnel jeune. Une augmentation des charges virales, liée à l’abandon des protocoles ARV, fragiliserait la préparation opérationnelle et l’aptitude au déploiement extérieur. Au-delà du facteur humain, les budgets défense seraient contraints d’absorber un surcoût sanitaire. D’où la multiplication, depuis 2024, de partenariats entre ministères de la Défense, Instituts Pasteur et alliances public-privé pour sécuriser la chaîne de diffusion d’informations médicales fiables. Dans un rapport interne consulté par nos soins, l’État-major français préconise la création d’une « cellule d’alerte biologique et informationnelle » arrimée au Commandement de l’espace numérique, capable de détecter les signaux faibles d’une campagne d’infox avant son emballement.
Bio-sécurité et renseignement : cartographie des menaces émergentes
Les services de renseignement, de leur côté, scrutent l’origine géographique et la sémantique de ces narratifs. Plusieurs analyses de métadonnées pointent vers des fermes à clics situées hors OCDE, utilisées indifféremment pour promouvoir des escroqueries financières ou instiller la méfiance envers les institutions occidentales. Cette hybridation brouille la frontière entre criminalité organisée et action d’influence étatique. À Bruxelles, le Centre d’excellence pour la contre-désinformation biologique a identifié, dans le code source de certains visuels, des signatures similaires à celles repérées lors des campagnes antivaccins dirigées contre les forces de l’OTAN déployées sur le flanc Est. Le spectre d’une manipulation orchestrée, visant à désorganiser la logistique santé des contingents, n’est plus théorique. Un analyste de l’EMA rappelle que « la supériorité opérationnelle ne se limite plus aux blindés ou aux drones ; elle se joue aussi sur la robustesse cognitive des troupes face aux rumeurs virales ».
Vers une doctrine intégrée de lutte contre les infox médicales
Face à cette menace composite, plusieurs pistes émergent. Premièrement, arrimer plus étroitement les centres de recherche militaire aux plateformes civiles de vérification, afin d’obtenir un démenti rapide et crédible. Deuxièmement, inscrire la santé publique dans la politique de résilience nationale, au même titre que l’énergie ou le cyberespace. Troisièmement, renforcer la formation des personnels en uniforme aux fondamentaux de la communication de crise sanitaire. Les pionniers canadiens ont, dès 2023, introduit dans les programmes de l’École de guerre une unité dédiée aux « facteurs humains et lutte cognitive », où l’exemple VIH sert de cas d’école. Reste l’enjeu diplomatique : imposer aux grandes plateformes un standard de diligence renforcée dès lors qu’un contenu médical viralise dans des zones à haute sensibilité stratégique. L’Union européenne discute d’un « Digital Health Act » qui inclurait un devoir de coopération avec les commandements interarmées en cas de crise. En l’absence d’une telle architecture normative, les forces se retrouvent à combattre un adversaire insaisissable, dématérialisé et protéiforme, qui menace autant le moral des troupes que la santé des populations civiles.