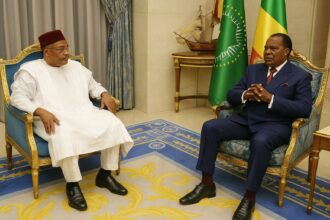Une réforme qui cible la redevabilité
Depuis la fin du premier trimestre, chaque agent de la Police des frontières en poste aux aéroports internationaux Maya-Maya de Brazzaville et Agostinho-Neto de Pointe-Noire arbore désormais un numéro à trois chiffres cousu sur la poitrine. Placée sous l’autorité directe du commandant de la sécurité publique, cette innovation s’inscrit dans la politique nationale dite de « tolérance zéro pour les entorses déontologiques ». Le colonel-major Gabin Ngoyela, devant un parterre de cadres aéroportuaires, a rappelé que « l’identification individuelle offre au citoyen un recours objectif et encourage une police de proximité plus crédible ».
Ce marquage simple, mais hautement symbolique, répond à une demande récurrente des usagers internationaux qui déplorent, dans toutes les capitales du continent, la difficulté d’attribuer un comportement répréhensible à un fonctionnaire précis. En donnant corps à la redevabilité, le Congo-Brazzaville rejoint ainsi le cercle restreint des États africains qui ont fait du numéro visible un outil de gouvernance sécuritaire.
Traçabilité et gouvernance sécuritaire
Sur le plan doctrinal, le numéro d’identification s’apparente à un vecteur de traçabilité qui complète l’arsenal existant : caméra-piéton, livrets de main courante numériques et circuits de plainte dématérialisés. Loin d’être anecdotique, cette approche s’insère dans le schéma directeur 2022-2026 du ministère de l’Intérieur, lequel prévoit une interconnexion progressive des bases de données policières à la plate-forme nationale de lutte contre la criminalité transfrontalière.
Dans la pratique, chaque matricule renvoie désormais à un référentiel biométrique conservé au Centre de renseignement et de coordination des frontières. L’agent voit donc sa trajectoire professionnelle, ses formations et, le cas échéant, ses sanctions, adossées à un identifiant unique consultable par la hiérarchie. En cas d’allégation d’abus, la chaîne de commandement peut lancer une vérification flash, réduire la temporalité de l’enquête et prendre des mesures conservatoires, comme l’illustre l’exclusion immédiate, la semaine dernière, de quatre policiers incriminés par un passager.
Professionnalisation aux points d’entrée aériens
Les plateformes aéroportuaires représentent le premier miroir du pays pour investisseurs et diplomates. Or, la densité du trafic régional – près de 900 000 passagers en 2023 selon l’Agence nationale de l’aviation civile – impose une montée en gamme des protocoles de sûreté. L’affichage d’un numéro clair participe d’un climat de confiance qui intéresse directement les opérateurs logistiques, les compagnies aériennes et les cellules consulaires.
À l’épreuve du terrain, l’identifiant évite également les confusions durant les opérations conjointes avec les forces armées ou les douanes, notamment lors de l’escorte de personnalités protégées. Pour le commandement des forces de police, le dispositif se double d’un « effet miroir » : l’agent se sait identifiable par les caméras de vidéosurveillance, mais aussi par le voyageur, ce qui l’invite à appliquer une posture irréprochable sans qu’il soit nécessaire d’accroître la pression hiérarchique.
Effet dissuasif et culture de conformité
Au-delà de la sanction, la réforme s’appuie sur un ressort psychologique. Les études de criminologie organisationnelle montrent qu’une identification visible réduit en moyenne de 30 % les comportements déviants dans les forces de sécurité. Le Congo-Brazzaville mise donc sur la prévention plutôt que sur la répression pour contenir les tentations d’extorsion ou de favoritisme.
Le dispositif nourrit également la formation initiale. Depuis avril, le Centre d’instruction de la police à Dolisie intègre une séquence spécifique consacrée aux « droits de l’usager mobile », couplée à des exercices de mise en situation où le matricule est un élément de mise en confiance du public. À moyen terme, cette pédagogie pourrait irriguer d’autres branches, telles que la police ferroviaire et la brigade fluviale, prolongements naturels d’une stratégie globale de sécurité des corridors logistiques nationaux.
Vers une convergence régionale des standards
L’initiative congolaise intervient alors que la Communauté économique des États d’Afrique centrale élabore un cadre commun pour la sûreté transfrontalière. Brazzaville, qui abritera l’an prochain un symposium dédié aux bonnes pratiques policières, entend y présenter le retour d’expérience de son identifiant individuel. Selon un diplomate en poste à Yaoundé, « le dispositif congolais pourrait servir de modèle, tant il conjugue simplicité technique et efficience disciplinaire ».
À terme, la généralisation de la mesure à l’ensemble des 8 000 policiers frontaliers du pays faciliterait l’échange d’informations opérationnelles avec les États voisins et renforcerait la posture de défense civile dans la zone CEMAC. Pour le président Denis Sassou Nguesso, qui promeut de longue date la sécurité comme préalable au développement économique, la démarche confirme la volonté de concilier modernisation institutionnelle et protection des citoyens.