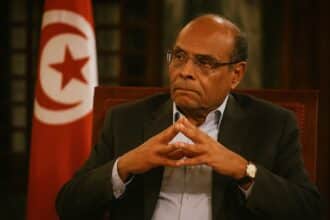Brazzaville place la barre haute pour la défense du ciel
Réunis le 17 octobre à Brazzaville, les ministres en charge des Transports des six États de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ont approuvé le plan d’action et le projet de budget 2026 de l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Sous la présidence assurée par la ministre congolaise Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, le Comité des ministres a affirmé la cohérence d’une vision : la sûreté aérienne n’est plus seulement un impératif civil, mais un volet essentiel de la défense collective, car la moindre faille dans la chaîne de contrôle du trafic ouvre un corridor aux menaces transnationales, de la contrebande à la projection illicite de groupes armés.
- Brazzaville place la barre haute pour la défense du ciel
- La Redevance de Sécurité Aérienne Régionale, levier de souveraineté
- Maîtrise budgétaire et gouvernance : une trajectoire vertueuse
- Harmonisation réglementaire : un pas décisif vers l’interopérabilité
- Capital humain : un plan triennal au service de la résilience
- Perspectives 2026 : convergence civilo-militaire et leadership congolais
Dans une région où 90 % des opérations extérieures et des acheminements humanitaires reposent sur la voie aérienne, l’Assa-Ac se voit confier la mission de garantir l’interopérabilité des dispositifs de surveillance du ciel avec ceux des forces aériennes nationales. « Stabiliser l’espace aérien, c’est aussi protéger le flux logistique de nos armées et de nos partenaires de maintien de la paix », a résumé Eugène Apombi, directeur général de l’Agence.
La Redevance de Sécurité Aérienne Régionale, levier de souveraineté
Le déploiement effectif, dans cinq États membres, de la Redevance de Sécurité Aérienne Régionale (RSAR) a été salué comme l’acquis budgétaire le plus structurant depuis la création de l’Assa-Ac. Indexée sur chaque billet émis, la RSAR offre une ressource propre et pérenne, à même de financer l’entretien des radars de veille primaire, la modernisation des centres de contrôle d’approche et l’équipement des inspecteurs habilités. Les ministres ont exhorté la direction générale à finaliser la contractualisation avec l’Association du transport aérien international pour sécuriser le recouvrement des sommes dues et à résorber les arriérés de contribution égalitaire.
Au-delà de l’équilibre financier, cette redevance consacre un principe de souveraineté : celui du financement par les usagers des infrastructures essentielles à la sécurité des passagers comme des forces armées. Les officiers de l’état-major du Groupement aérien congolais rappellent que les mêmes radars civils servent, en temps de crise, à écarter les trafics illicites ou à baliser les couloirs d’évacuations médicales.
Maîtrise budgétaire et gouvernance : une trajectoire vertueuse
Le Comité a entériné les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et validé une trajectoire de réduction des charges de fonctionnement. Les rapports administratifs et de gestion seront désormais systématiquement approuvés par les organes statutaires avant transmission aux juridictions financières, renforçant ainsi la transparence attendue par les partenaires techniques et les bailleurs. Pour le spécialiste en finances publiques Guy-Noël Makaya, ce mécanisme « rapproche l’Agence des meilleures pratiques OTAN en matière de comptabilité analytique et de contrôle interne, indispensable lorsqu’une structure civile soutient des objectifs sécuritaires continentaux ».
Dans le même esprit, le Congo, qui assure la présidence tournante, a défendu la création d’un tableau de bord trimestriel partagé avec les centres de commandement nationaux, permettant d’anticiper les besoins capacitaires et, le cas échéant, de mutualiser certains achats stratégiques, notamment pour la maintenance des radio-balises et des systèmes ADS-B.
Harmonisation réglementaire : un pas décisif vers l’interopérabilité
La migration complète vers la réglementation communautaire avant le 31 décembre 2026 constitue le défi technique le plus complexe mais aussi le plus prometteur. L’adoption de règles communes en matière de certification, de surveillance et d’enquêtes d’accident doit simplifier les coopérations interarmées, en évitant la juxtaposition de législations nationales parfois obsolètes. Dans une déclaration conjointe, les délégations du Cameroun et du Tchad ont souligné que la mutualisation des procédures d’enquête facilitera la remontée d’enseignements confidentiels utiles aux écoles de guerre aérienne régionales.
Conscients des lenteurs administratives, les ministres ont mandaté le directeur général pour solliciter, auprès du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale, une délégation exceptionnelle de pouvoir, accélérant la signature des amendements nécessaires. « L’objectif est clair : un ciel unique d’ici trois ans, contrôlé selon des standards comparables à ceux de l’EASA et de l’OACI », résume un cadre de l’Armée de l’air congolaise.
Capital humain : un plan triennal au service de la résilience
Au-delà des équipements, le facteur humain demeure le cœur de la sécurité. Le plan triennal 2026-2028 de formation, adopté à Brazzaville, cible les contrôleurs, inspecteurs, mais aussi les juristes chargés de rédiger les futures doctrines. Il prévoit la création, au sein de chaque État, d’un vivier de formateurs capable d’intervenir en appui aux opérations militaires, notamment lors des exercices combinés d’assistance humanitaire. Une enveloppe dédiée sera allouée à l’entraînement croisé avec les forces spéciales, intégrant des modules d’instruction sur la neutralisation de drones maléfiques et la protection des infrastructures aéroportuaires sensibles.
Leyami Gastel Aimard, fraîchement nommé directeur de l’administration et des finances, a insisté sur l’effet multiplicateur de cette stratégie : « Un technicien parfaitement formé représente autant de vies sauvées et de missions réussies, civiles comme militaires ».
Perspectives 2026 : convergence civilo-militaire et leadership congolais
En donnant à l’Assa-Ac les moyens de ses ambitions, les États de la CEMAC entérinent une approche intégrée de la sécurité, où les composantes civiles et militaires ne se superposent plus mais agissent de concert. Le Congo, dont la géographie fait de ses aéroports un pivot naturel entre golfe de Guinée et intérieur continental, assume un rôle moteur. Brazzaville se positionne ainsi comme un hub de la résilience aérienne, concourant à la libre circulation des personnes, au développement économique et à la prévention des menaces asymétriques.
À l’horizon 2026, la pleine opérationnalisation de la RSAR, l’harmonisation réglementaire et le renforcement des compétences devraient rehausser le classement sécurité de la région dans les audits internationaux. Surtout, elle offrira aux forces armées un réseau d’appui logistique et de renseignement cohérent, gage de dissuasion et de stabilité. Dans une conjoncture marquée par la montée des risques hybrides, la sûreté aérienne devient ainsi l’un des piliers stratégiques sur lesquels reposent la paix et le développement de l’Afrique centrale.