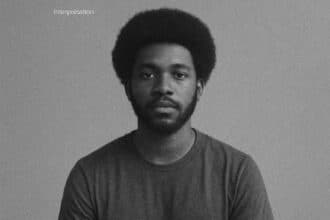Un corridor fluvial sous haute surveillance
La frontière occidentale du Kasaï, théâtre du nouvel épisode d’Ebola, n’est séparée de Brazzaville que par la largeur majestueuse du fleuve Congo. Chaque aube voit des barges légères et des pirogues motorisées jeter l’ancre sur les rives congolaises, transportant passagers, marchandises et espérances économiques. Cette mobilité, indispensable à la vie des cités jumelles, constitue néanmoins un vecteur potentiel de contamination. Conscient de cet enjeu, le gouvernement a ordonné la montée en puissance immédiate des dispositifs de surveillance aux points d’entrée fluviaux, combinant contrôle sanitaire et sécurisation policière. Les patrouilles mixtes Police–Forces navales, déployées dès l’annonce du foyer épidémique, veillent désormais jour et nuit, gilets pare-balles et thermomètres infrarouges côte à côte.
- Un corridor fluvial sous haute surveillance
- Évaluation nationale : un test grandeur nature de résilience
- Police, douanes, armée : la même chaîne d’alerte
- Santé militaire : colonne vertébrale de l’évacuation médicale
- L’OMS, partenaire capacitaire et multiplicateur de force
- Vers une doctrine congolaise de sécurité sanitaire
- Une vision durable de défense civile intégrée
Évaluation nationale : un test grandeur nature de résilience
Sous la houlette du ministère de la Santé et de la Population, une mission interministérielle a conduit, en quarante-huit heures, l’audit de préparation nationale. Cartographie des capacités d’isolement, inventaire des stocks de matériels de protection, chaînes d’alerte entre préfectures et commandements de zone : chaque maillon a été passé au crible. « Nous devons fonctionner comme lors d’un exercice militaire de niveau national », confie le Dr Jean Claude Emeka. Cette approche, inspirée des doctrines de défense civile, vise non seulement à contrer la menace Ebola, mais à éprouver la robustesse globale du dispositif de gestion de crise, de la cellule gouvernementale jusqu’au terrain opérationnel.
Police, douanes, armée : la même chaîne d’alerte
Au Beach de Brazzaville, principal port passagers, l’uniforme bleu nuit du corps des douanes côtoie le treillis centre-africain des bataillons fluviaux. Le Plan national de préparation et de riposte, mis à jour en partenariat avec l’OMS, aligne clairement les responsabilités : fouille documentaire, prise de température, filtrage biométrique et, en cas de suspicion, escorte armée vers l’ambulance dédiée. Christian Voumina, chef d’exploitation de l’aéroport Maya-Maya, rappelle que « prévenir vaut mieux que guérir ». Ses propos résonnent avec la directive conjointe Défense-Intérieur, signée en août, qui impose un horizon d’intervention inférieur à trente minutes entre détection et isolement, quel que soit le poste frontalier concerné.
Santé militaire : colonne vertébrale de l’évacuation médicale
L’Hôpital militaire de Brazzaville, mobilisé en première ligne, a réactivé deux unités d’isolement à pression négative. Des équipes mixtes Service de santé des armées–Croix-Rouge congolaise effectuent des rotations d’astreinte. Pour le général-médecin Marcel Okouba, commandant du service, « l’enjeu est double : protéger la troupe et offrir aux civils la même garantie de soins. » Une ambulance médicalisée, blindée léger, assure le transport des cas suspects sous escorte de la gendarmerie, afin de limiter les contacts non essentiels. Cette logistique éprouvée lors des exercices « Mboko » de lutte contre les épidémies, constitue aujourd’hui un atout déterminant.
L’OMS, partenaire capacitaire et multiplicateur de force
Le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé à Brazzaville n’a pas attendu pour soutenir la stratégie nationale. Impression de supports pédagogiques, dotation de thermo-scanners, coaching de formateurs : autant de leviers activés pour densifier la riposte. « Cet engagement va au-delà d’Ebola, il s’inscrit dans une approche globale de préparation aux crises », insiste le Dr Vincent Dossou Sodjinou. Les 1 000 affiches diffusées dans les gares fluviales et les 100 participants formés le 23 septembre ne relèvent donc pas d’un simple geste de communication, mais d’un investissement dans le capital humain, clef de voûte de la sécurité nationale.
Vers une doctrine congolaise de sécurité sanitaire
L’expérience des précédentes flambées épidémiques a montré que la première ligne de défense n’est pas seulement médicale, mais résolument sécuritaire. C’est pourquoi la Direction générale de la police et le Commandement de la gendarmerie ont intégré la vigilance épidémiologique à leurs plans d’action. Des modules sur les zoonoses et les protocoles de confinement figurent désormais au cursus des écoles d’application. Le Dr Emeka rappelle que « nous partageons plus de mille kilomètres de frontière et une communauté humaine indivisible ». Face à cette porosité, la réponse congolaise se veut holistique : renseignement intérieur, diplomatie sanitaire avec Kinshasa, et participation des tradipraticiens à la détection précoce.
Une vision durable de défense civile intégrée
Au-delà de l’urgence, Brazzaville fait le pari d’inscrire cette mobilisation dans la durée. Le Conseil national de sécurité a validé l’intégration d’un volet « menaces biologiques » au Livre blanc de la défense, actuellement en révision. Les investissements consentis – isolements hospitaliers, formation des forces, dispositifs de détection – irrigueront d’autres volets de la résilience, qu’il s’agisse de grippe aviaire, de fièvre de Marburg ou de contaminations chimiques accidentelles. Ainsi, l’alerte Ebola agit comme un catalyseur, accélérant la mue d’un système de défense civile qui conjugue santé publique, sécurité intérieure et appui militaro-logistique. Une manière, pour la République du Congo, de rappeler qu’à l’heure des épidémies transfrontalières, la souveraineté s’exerce aussi dans la maîtrise des risques sanitaires.