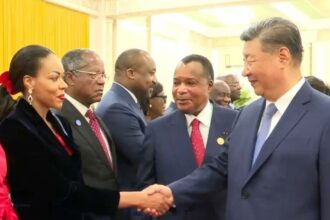Un enjeu sécuritaire émergent
Le fracas des vagues de l’Atlantique sur la côte de Pointe-Noire ne couvre plus les préoccupations des autorités congolaises face aux nouveaux fronts de la sûreté intérieure. Longtemps cantonnée aux sphères humanitaires, la protection des défenseurs de l’environnement apparaît désormais comme un sujet stratégique, au même titre que la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Du 9 au 10 octobre, l’initiative Lead, portée par Yvan Kibangou Ngoy, a réuni des activistes et des experts d’Afrique centrale afin de réfléchir, avec le concours des acteurs gouvernementaux, à la sécurisation de ceux qui interviennent sur des écosystèmes sensibles.
- Un enjeu sécuritaire émergent
- Cartographie des menaces régionales
- Priorité à la protection proactive
- Forces de défense et de sécurité en première ligne
- Partenariats civilo-militaires innovants
- Diplomatie sous-régionale et espace multilatéral
- Perspectives technologiques et industrielles
- Cap sur une stratégie nationale intégrée
Cartographie des menaces régionales
Les échanges ont d’abord fait ressortir une typologie de risques que les analystes de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure décrivent comme « asymétriques et diffus ». Menaces physiques directes contre les militants ruraux opposés aux coupes illégales, pressions judiciaires instrumentalisées, campagnes de désinformation en ligne et, plus rarement, recours à la violence armée par des groupes criminels intéressés par l’exploitation minière clandestine : autant de facteurs déstabilisants qui nécessitent l’activation simultanée du renseignement territorial, de la police scientifique et des unités spécialisées de la gendarmerie nationale.
Priorité à la protection proactive
Dans un contexte où les « espaces civiques » se contractent sous l’effet des tensions socio-économiques, le ministère de l’Intérieur a rappelé la primauté du cadre légal congolais, lequel reconnaît la liberté d’association, tout en imposant des mécanismes d’agrément destinés à prévenir l’infiltration d’acteurs malveillants. Une cellule d’alerte précoce, adossée au Centre national de gestion des crises, a été proposée. Elle permettra, selon le colonel-major Arsène Mbemba, de « détecter en temps réel les signaux faibles de harcèlement et de déclencher, si nécessaire, l’escorte ou la relocalisation temporaire d’un défenseur exposé ».
Forces de défense et de sécurité en première ligne
Les forces armées congolaises, déjà engagées dans la surveillance côtière au titre de l’opération Sécurité Golfe, voient leur spectre d’action s’élargir. Les bataillons d’infanterie légère de Pointe-Noire, formés à la protection des sites pétroliers, bénéficieront d’un module complémentaire sur l’accompagnement des missions scientifiques et la gestion de scènes d’infraction environnementale. Le commandant de zone, le général Jean-Baptiste Okombi, a insisté sur « l’impératif d’une posture de dissuasion graduée », alliant présence visible, médiation et, en dernier ressort, intervention armée encadrée par le droit interne.
Partenariats civilo-militaires innovants
L’atelier a consacré la montée en puissance de formats hybrides dans lesquels organisations non gouvernementales, start-up de géomatique et forces de sécurité partagent données et protocoles. Le projet « Forêt Veille 360 » illustre cette dynamique : des capteurs placés sur des essences protégées transmettent, via la constellation nanosatellite Congsat-1, des alertes de coupe illégale directement au poste de commandement de la gendarmerie. En retour, les ONG reçoivent des informations de situation pour ajuster leurs actions de plaidoyer. Cette porosité volontaire entre sphères civile et militaire contribue à bâtir la confiance recherchée par Lead.
Diplomatie sous-régionale et espace multilatéral
Parce que les menaces ne connaissent pas de frontières, la diplomatie congolaise s’appuie sur la CEEAC pour promouvoir un instrument régional de protection des activistes environnementaux, inspiré du mécanisme onusien des défenseurs des droits de l’homme. Brazzaville plaide pour un fonds de solidarité alimenté par les États membres et les compagnies extractives opérant dans le bassin du Congo. Selon un conseiller au ministère des Affaires étrangères, « ce fonds financerait les frais juridiques, la cybersécurité et les évacuations d’urgence, renforçant l’image de stabilité de la sous-région auprès des investisseurs ».
Perspectives technologiques et industrielles
La réflexion sécuritaire ouvre également des débouchés industriels. Le Service des achats de l’État identifie déjà des opportunités pour les PME congolaises spécialisées dans les drones à voilure fixe, capables de cartographier en haute résolution des zones forestières difficiles d’accès. Des partenariats sont envisagés avec la société publique pétrolière afin d’intégrer ces vecteurs aériens dans les plans de surveillance pipeline-forêt. Au-delà du matériel, la filière de la cyber-analyse voit se multiplier les besoins en cryptographie souveraine pour protéger les communications entre activistes et autorités.
Cap sur une stratégie nationale intégrée
La conclusion des travaux de Pointe-Noire acte la nécessité de consolider, dans la future Stratégie nationale de sécurité intérieure, un chapitre dédié aux défenseurs de l’environnement. L’État, les forces de défense, la société civile et le secteur privé convergent vers une doctrine de « sécurité écologique » qui vise la résilience des écosystèmes autant que celle des communautés. En alliant veille technologique, coopération transfrontalière et respect des libertés publiques, le Congo se positionne comme un acteur moteur en Afrique centrale, capable de concilier développement économique, stabilité et préservation du patrimoine naturel.